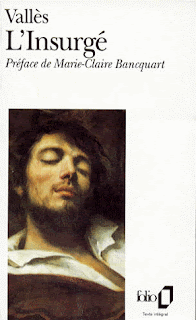Paul Gauguin - Alors, vos chiens rouges, vos ciels roses ?
"Question. - Alors, vos chiens rouges, vos ciels roses ?
Réponse. - [Ils] sont voulus absolument ! ils sont nécessaires et tout dans mon œuvre est médité, calculé longuement.
C'est de la musique si vous voulez !
J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, des symphonies, des harmonies ne représentant rien d’absolument réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par les affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs ou de lignes."
Extrait d'une interview de Gauguin dans l'Echo de Paris, 13 mai 1895.
Jules Vallès - L'insurgé
Jules Vallès, L'insurgé, Publié en 1886
« Aux morts de 1871
À TOUS CEUX
qui, victimes de l’injustice sociale,
prirent les armes contre un monde mal fait
et formèrent,
sous le drapeau de la Commune,
la grande fédération des douleurs,
Je dédie ce livre.
Jules VALLÈS. »
« Voilà des semaines que j’attends, du fond de mon trou, une occasion de leur filer entre les doigts.
Leur échapperai-je ? … je ne crois pas.
Par deux fois, je me suis trahi. Des voisins ont pu voir sortir ma tête, blême comme celle d’un noyé.
Tant pis ! si l’on me prend, on me prendra !
Je suis en paix avec moi-même.
Je sais, maintenant, à force d’y avoir pensé dans le silence, l’œil fixé à l’horizon sur le poteau de Satory – notre crucifix à nous ! – je sais que les fureurs des foules sont crimes d’honnêtes gens, et je ne suis plus inquiet pour ma mémoire, enfumée et encaillotée de sang.
Elle sera lavée par le temps, et mon nom restera affiché dans l’atelier des guerres sociales comme celui d’un ouvrier qui ne fut pas fainéant.
Mes rancunes sont mortes – j’ai eu mon jour.
Bien d’autres enfants ont été battus comme moi, bien d’autres bacheliers ont eu faim, qui sont arrivés au cimetière sans avoir leur jeunesse vengée.
Toi, tu as rassemblé tes misères et tes peines, et tu as amené ton peloton de recrues à cette révolte qui fut la grande fédération des douleurs.
De quoi te plains-tu ? …
C’est vrai. La Perquisition peut venir, les soldats peuvent charger leurs armes – je suis prêt.
……………
Je viens de passer un ruisseau qui est la frontière.
Ils ne m’auront pas ! Et je pourrai être avec le peuple encore, si le peuple est rejeté dans la rue et acculé dans la bataille.
Je regarde le ciel du côté où je sens Paris.
Il est d’un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse inondée de sang. »
Jonathan Coe - La vie très privée de Mr Sim
Jonathan Coe, La vie privée de Mr Sim (The terrible privacy of Maxwell Sim), publié en 2010
Avec La vie très privée de Mr Sim, Jonathan Coe fait à nouveau le choix de s’éloigner de ce que ses lecteurs attendent de lui. La critique de l’Angleterre Thatchérienne et du néolibéralisme présente dans Testament à l’anglaise puis dans Bienvenue au club, la dénonciation du Blairisme et du New Labour dans Le cercle fermé ne semblent plus inspirer l’auteur. Peut-être souhaite-t-il arracher l’étiquette d’écrivain « politique » qui lui colle à la peau. La pluie, avant qu’elle tombe, son précédent livre, était comme en apesanteur, loin de toute préoccupation sociale, exclusivement focalisé sur une tragédie familiale. Le livre était pourtant parfaitement écrit, structuré avec l’originalité caractéristique de l’auteur et l’épaisseur du mystère donnait au récit un intérêt particulier. Au contraire, La vie très privée de Mr Sim semble tourner à vide, écrit dans un style certes plaisant, mais sans aucune beauté et sans originalité dans la narration. Un livre mineur. Souhaitant prendre le contre-pied, Jonathan Coe manque le but.
Maxwell Sim, responsable du service après-vente d’un grand magasin, nous raconte sa brusque descente aux enfers, puis sa lente remontée. A la suite du départ de sa femme, qui part avec sa fille dans ses bagages, Max sombre dans la dépression. Il abandonne son travail et ses anciens amis, se laisse dériver lentement. Quelques mois plus tard, il devient représentant en brosses à dents, jusqu’au jour où la police le retrouve nu, dans un coma éthylique, au volant de sa voiture, sur le bord de la route. Dans l’essentiel du récit, Max se remémore les jours qui ont précédé l’évènement, les diverses rencontres et les découvertes sur sa propre vie, qui l’ont poussé vers cet épisode humiliant.
Maxwell Sim est donc un antihéros, un homme médiocre et en déroute. Ecrire un roman sur un type médiocre peut être une bonne idée, mais Jonathan Coe semble s’être fourvoyé en écrivant ce roman à la première personne. En effet, si Max est un homme médiocre, sa prose l’est également, et le lecteur prend peu de plaisir à le lire. D’ailleurs Max se vante de n’avoir jamais lu de roman et insiste à plusieurs reprises sur la pauvreté de son style ou de ses descriptions. A part le défi d’écrire à la manière d’une personne peu à l’aise avec l’écrit, on ne comprend pas bien l’intérêt d’un tel procédé narratif. Au final, on a l’impression de lire un mauvais livre de Michel Houellebecq où la médiocrité des hommes serait le pendant de la médiocrité de notre époque. Ce pseudo désenchantement vis-à-vis du monde moderne s’accompagne de ses figures déjà éculées : Coe s’adonne à l’art facile du name-dropping (les Ritazza Caffè, les costumes Hugo Boss ou la Toyota Prius), au héros qui n’a pas d’autres amis que ses amis Facebook et qui tombe amoureux de la voix féminine de son GPS. Le tout n’est pas seulement facile et déjà-vu. C’est surtout pas drôle et bête.
Conscient de la pauvreté du style de son récit, Coe essaye de compenser par l’intermédiaire de ses traditionnels changements de supports narratifs. Quatre parenthèses sont insérées à l’intérieur du récit : des nouvelles écrites par des proches de Max lui permettant d’avoir des informations sur son passé. Dans une nouvelle écrite par son père, Max apprend par exemple qu’il n’était pas souhaité par ses parents. Dans ses romans précédents, Jonathan Coe excellait dans cet exercice – qu’on se rappelle des extraits du journal intime de Benjamin dans Bienvenue au Club. Ici, on a l’impression que l’auteur se force. Ces nouvelles tombent comme un cheveu sur la soupe et le style n’est pas forcement plus réussi que la prose de Max.
Heureusement, les réflexions de Jonathan Coe sur la société moderne font encore mouche. Son regard est toujours aiguisé pour décrire les contradictions et les absurdités de notre époque. Quelques beaux passages mettent en lumière la solitude croissante de nombreuses personnes malgré l’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la multiplication des relations froides et polluées par l’intérêt marchand, l’uniformisation des villes anglaises dans lesquelles on retrouve partout les mêmes chaînes de restaurants, l’absurdité de la communication et du marketing où chaque marque fait n’importe quoi pour se faire remarquer, les dérives de la finance qui ont entrainé le chômage et la désindustrialisation, etc. De même, la psychologie des personnages est parfaitement maitrisée, le lecteur comprend comment une personne peut progressivement perdre les pédales.
Pourtant, cela ne suffit pas. Le talent du romancier anglais ne peut définitivement pas s’exprimer à travers les mots de Maxwell Sim.
Maxwell Sim, responsable du service après-vente d’un grand magasin, nous raconte sa brusque descente aux enfers, puis sa lente remontée. A la suite du départ de sa femme, qui part avec sa fille dans ses bagages, Max sombre dans la dépression. Il abandonne son travail et ses anciens amis, se laisse dériver lentement. Quelques mois plus tard, il devient représentant en brosses à dents, jusqu’au jour où la police le retrouve nu, dans un coma éthylique, au volant de sa voiture, sur le bord de la route. Dans l’essentiel du récit, Max se remémore les jours qui ont précédé l’évènement, les diverses rencontres et les découvertes sur sa propre vie, qui l’ont poussé vers cet épisode humiliant.
Maxwell Sim est donc un antihéros, un homme médiocre et en déroute. Ecrire un roman sur un type médiocre peut être une bonne idée, mais Jonathan Coe semble s’être fourvoyé en écrivant ce roman à la première personne. En effet, si Max est un homme médiocre, sa prose l’est également, et le lecteur prend peu de plaisir à le lire. D’ailleurs Max se vante de n’avoir jamais lu de roman et insiste à plusieurs reprises sur la pauvreté de son style ou de ses descriptions. A part le défi d’écrire à la manière d’une personne peu à l’aise avec l’écrit, on ne comprend pas bien l’intérêt d’un tel procédé narratif. Au final, on a l’impression de lire un mauvais livre de Michel Houellebecq où la médiocrité des hommes serait le pendant de la médiocrité de notre époque. Ce pseudo désenchantement vis-à-vis du monde moderne s’accompagne de ses figures déjà éculées : Coe s’adonne à l’art facile du name-dropping (les Ritazza Caffè, les costumes Hugo Boss ou la Toyota Prius), au héros qui n’a pas d’autres amis que ses amis Facebook et qui tombe amoureux de la voix féminine de son GPS. Le tout n’est pas seulement facile et déjà-vu. C’est surtout pas drôle et bête.
Conscient de la pauvreté du style de son récit, Coe essaye de compenser par l’intermédiaire de ses traditionnels changements de supports narratifs. Quatre parenthèses sont insérées à l’intérieur du récit : des nouvelles écrites par des proches de Max lui permettant d’avoir des informations sur son passé. Dans une nouvelle écrite par son père, Max apprend par exemple qu’il n’était pas souhaité par ses parents. Dans ses romans précédents, Jonathan Coe excellait dans cet exercice – qu’on se rappelle des extraits du journal intime de Benjamin dans Bienvenue au Club. Ici, on a l’impression que l’auteur se force. Ces nouvelles tombent comme un cheveu sur la soupe et le style n’est pas forcement plus réussi que la prose de Max.
Heureusement, les réflexions de Jonathan Coe sur la société moderne font encore mouche. Son regard est toujours aiguisé pour décrire les contradictions et les absurdités de notre époque. Quelques beaux passages mettent en lumière la solitude croissante de nombreuses personnes malgré l’avènement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, la multiplication des relations froides et polluées par l’intérêt marchand, l’uniformisation des villes anglaises dans lesquelles on retrouve partout les mêmes chaînes de restaurants, l’absurdité de la communication et du marketing où chaque marque fait n’importe quoi pour se faire remarquer, les dérives de la finance qui ont entrainé le chômage et la désindustrialisation, etc. De même, la psychologie des personnages est parfaitement maitrisée, le lecteur comprend comment une personne peut progressivement perdre les pédales.
Pourtant, cela ne suffit pas. Le talent du romancier anglais ne peut définitivement pas s’exprimer à travers les mots de Maxwell Sim.
« J'ai déjeuné tard, dans un certain Caffè Ritazza, sur l'aire de Knutsford. Comme je roulais lentement depuis Lichfield pour faire des économies d'essence, il était déjà deux heures et demie quand je suis arrivé. Le café (peut-être faudrait-il dire « caffè » ?) se trouvait au premier étage, à l'entrée de la passerelle qui enjambait l'autoroute, reliant les deux moitiés de l'aire de services, et je me suis attablé devant les baies vitrées pour regarder passer les voitures. Ainsi occupé, je repensais au Dr Hameed et à Miss Erith, en route pour la campagne où ils iraient se régaler dans leur pub tout en déplorant la mort lente de l'Angleterre chère à leur souvenir. Je n'étais pas sûr de partager leur point de vue. Certes, je soutenais la philosophie des Brosses à Dents Guest, mais à titre personnel j'apprécie beaucoup de pouvoir arriver dans n'importe quelle ville, de nos jours, avec l'assurance d'y trouver les mêmes boutiques, les mêmes bars, les mêmes restaurants. Parce que les gens ont besoin de cohérence, dans leur vie. De cohérence, de continuité, ces choses-là. Sinon, c'est tout de suite le bazar, les problèmes. Vous arrivez dans une ville inconnue, Northampton, mettons, et vous n'y trouvez que des restaurants dont le nom ne vous dit rien. Il va falloir en choisir un au hasard, sur la simple foi de la carte, ou de ce qu'on aperçoit derrière la vitre. Et si on y sert de la merde? N'est-il pas plus agréable de savoir que partout dans le pays on trouvera un Pizza Express, où commander une américaine épicée, avec des olives noires en supplément? N'est-il pas plus agréable d'en finir avec les mauvaises surprises? Moi, je trouve que si. »
Italo Calvino - Le baron perché
Italo Calvino, Le baron perché (Il barone rampante) publié en 1957
"En somme, Côme parvenait à tout faire dans les arbres.
Il avait même trouvé le moyen de faire rôtir son gibier à la broche. Voici comment il s'y prenait: il allumait une pomme de pin avec un briquet et la lançait à terre, dans un âtre en pierres lisses que je lui avait installé. Sur la il pomme, laissait tomber des brindilles et des branches de fagots ; au moyen de chenêts attachés à un long bâton, il réglait ensuite la flamme pour qu'elle atteignît la broche, suspendue entre deux branches. Tout cela demandait de l’attention : dans les bois, on a vite fait de provoquer un incendie. Le foyer avait été installé sous le chêne, près de la cascade ; en cas de danger, on disposerait d'autant d’eau qu'on en voudrait.
En mangeant une partie du produit de ses chasses et en troquant le reste contre les fruits et les légumes des paysans, Côme vivait tout à fait bien, sans plus avoir besoin que notre maison lui fournît quoi que ce fût. Un jour, nous apprîmes qu'il buvait chaque matin son lait frais : il avait lié amitié avec une chèvre qui grimpait dans une fourche d'olivier - un endroit facile, à deux pieds de terre - où plus exactement appuyait là ses deux pattes de derrière ; lui, descendait jusqu'à la fourche avec un seau et trayait la bête. II avait passé le même accord avec une poule, une bonne grosse poule rouge de Padoue. II lui avait installé un nid caché, au creux d'un tronc, et trouvait là un jour sur deux un œuf; il y pratiquait deux trous d’épingle et le gobait.
Autre problème: faire ses besoins. Au début, il n'y regardait pas de si près: ici ou là, le monde est grand, il faisait là où il se trouvait. Puis il s'avisa que ce n'était pas bien agir. II découvrit sur les bords d'un torrent, la Merdance, au point le plus propice et le plus écarté, un aulne qui faisait saillie, avec une fourche sur laquelle on pouvait se tenir très commodément assis. La Merdance était une rivière obscure, au cours rapide, cachée sous les roseaux, et les pays voisins y faisaient déboucher leurs égouts. Le jeune Laverse du Rondeau vivait en civilisé, respectueux de lui-même comme de son prochain."
Claude Monet (1840 - 1926) (24 janvier 2011)
Claude Monet (1840 - 1926), Rétrospective au grand palais (22 septembre 2010 - 24 janvier 2011)
 |
| La Rue Montorgueil, fête du 30 juin 1878 (1878) Paris, musée d'Orsay |
 |
| Le parlement, trouée de soleil dans le brouillard (1904) Paris, musée d'Orsay |
 |
| La côte sauvage (1886) Paris, musée d'Orsay |
 |
| La terrasse à Sainte-Adresse (1867) New York, Metropolitan Museum of Art |
 |
| La gare Saint-Lazare, le train de Normandie (1877) Chicago, Art institute of Chicago |
 |
| Effet de neige à Giverny (1893) New Orleans, collection privée |
 |
| Camille Monet sur son lit de mort (1879) Paris, Musée d'Orsay |
 |
| La falaise à Dieppe (1882) Zurich, Kunsthaus Zurich |
 |
| Le bassin aux nymphéas, harmonie verte (1899) Paris, Musée d'Orsay |
 |
| Les déchargeurs de charbon (1875) Paris, Musée d'Orsay |
 |
| Le portail vu de face, harmonie brune (1892-94) Paris, Musée d'Orsay |
 |
| Autoportrait (1917) Paris, Musée d'Orsay |
Inscription à :
Articles (Atom)